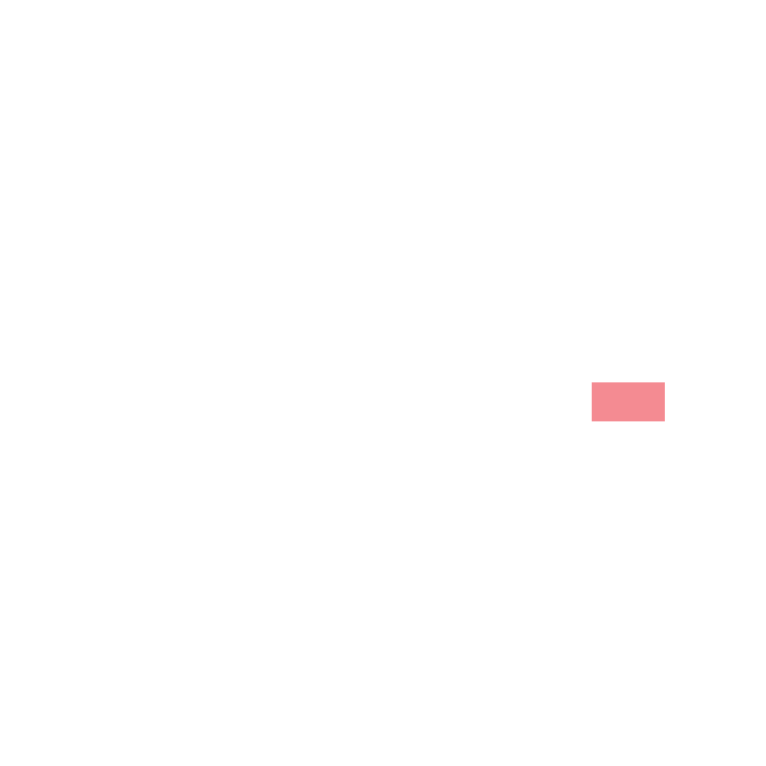26. août 2022
Just right policing – Conférence à Cambridge
Consacrée à la thématique du just right policing, la Cambridge Evidence-Based Policing Conference 2022 a réuni des spécialistes reconnu·e·s mondialement de l’evidence-based policing, dont l’objectif est d’intégrer les données de la recherche scientifique de manière ciblée dans l’activité opérationnelle des forces de police.
La recherche appliquée au service d’une activité de police performante et ciblée
 L’Institut Suisse de Police a eu le privilège de participer à l’édition 2022 de la Cambridge Evidence-Based Policing Conference, une conférence internationale qui réunit chaque année des spécialistes réputé·e·s de l’evidence-based policing (EBP, ou « police guidée par les éléments probants de la recherche »). Davantage développé dans les pays anglo-saxons, l’EBP a pour but de soutenir un travail de police performant et adapté, en intégrant de manière ciblée les données d’études scientifiques réalisées souvent de façon conjointe par des corps de police et des universitaires, la plupart du temps sous forme d’essais randomisés contrôlés.
L’Institut Suisse de Police a eu le privilège de participer à l’édition 2022 de la Cambridge Evidence-Based Policing Conference, une conférence internationale qui réunit chaque année des spécialistes réputé·e·s de l’evidence-based policing (EBP, ou « police guidée par les éléments probants de la recherche »). Davantage développé dans les pays anglo-saxons, l’EBP a pour but de soutenir un travail de police performant et adapté, en intégrant de manière ciblée les données d’études scientifiques réalisées souvent de façon conjointe par des corps de police et des universitaires, la plupart du temps sous forme d’essais randomisés contrôlés.
Ce n’est pas un hasard si cette conférence est organisée chaque année par l’Université de Cambridge, qui propose, outre des activités de recherche spécifiques sur la police, une formation unique destinée aux cadres de police britanniques et internationaux, le Master of Studies (MSt) in Applied Criminology and Police Management.
Sous la direction du professeur Lawrence Sherman, l’un des spécialistes mondiaux de l’EBP, la conférence était consacrée à la thématique du just right policing. Dans un contexte où la légitimité de la police est parfois mise à mal dans les pays anglo-saxons, le just right policing est un concept visant à trouver un fin équilibre dans l’activité policière. L’objectif est d’éviter, grâce à la recherche scientifique, tant l’under-policing, une situation où la police ne répond pas aux besoins sécuritaires dans certaines zones ou vis-à-vis de certains groupes de la population, que l’over-policing, qui caractérise une situation où la police se montre indûment trop présente, par exemple en procédant à un nombre excessif de contrôles de personnes.
Hot spots policing, justice procédurale et lutte contre la violence faite aux femmes
Parmi les sujets mis en avant cette année, on note plusieurs études consacrées au hot spots policing. Récompensé de la Sir Robert Peel Medal, David Weisburd a présenté une étude multisites dédiée à l’intégration d’une formation liée à la justice procédurale dans des programmes de hot spots policing, avec des résultats très probants tant en matière d’efficacité que de légitimité policières.
Parallèlement, différentes présentations traitaient de la violence faite aux femmes, thématique prioritaire au Royaume-Uni ; en effet, le pays a décidé de se doter d’une stratégie et d’un groupe de travail interdisciplinaire actif sur le plan national afin d’améliorer significativement la prévention et la répression de la violence à l’encontre des femmes et des filles.
D’autres exposés étaient notamment consacrés à la mise en place d’une prise en charge accélérée des victimes de violence domestique à l’aide de prises de contact par visioconférence ou encore à un projet destiné à prévenir la déviance policière au moyen d’un outil prédictif.
Perspectives et développements sur le plan national et international
Au Royaume-Uni, tant les universités que le College of Policing, mais aussi de nombreux corps de police ont développé des capacités de recherche utiles à l’activité policière, à l’instar de la Metropolitan Police, la police de Londres, qui dispose d’une entité de recherche interdisciplinaire à part entière.
Certains pays, comme la Nouvelle-Zélande, qui a mis sur pied le New Zealand Evidence-Based Centre, ont doté leurs forces de police de capacités développées en matière d’EBP et intègrent de manière coordonnée la recherche scientifique et ses résultats dans la planification opérationnelle de la police. D’autres initiatives intéressantes émanent des États-Unis, d’Australie ou encore de Suède.