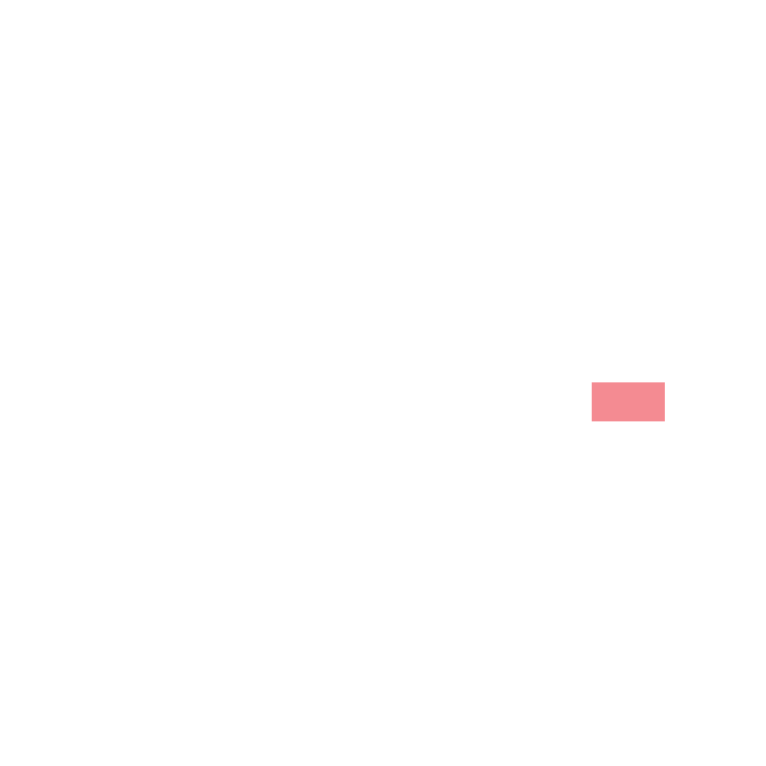15. juin 2021
Journée d’information des directions de cours : le coronavirus, catalyseur de l’innovation
Cette année, la journée d’information des directions de cours ISP a permis de faire le bilan des expériences et leçons tirées de la crise du coronavirus. En outre, elle a été l’occasion d’étudier les possibilités offertes par l’enseignement à distance ainsi que ses limites et de se projeter dans le futur rôle des instructrices et instructeurs.
 Impacts directs de la pandémie
Impacts directs de la pandémie
Cela fait déjà un certain temps que la crise du coronavirus touche le domaine « Cycles de formation et cours » de l’ISP. Il a fallu s’adapter à des conditions en constante évolution et étudier chacune des formations pour savoir si elle pouvait être organisée. Des rapports de situation réguliers sont venus appuyer une planification plus flexible des formations. Pour chaque cours, la même marche à suivre : appréhension du problème, appréciation de la situation et prise de décision. Reprendre les principes de conduite tirés des formations ISP destinées aux cadres s’est avéré un choix judicieux dans la pratique.
Concrètement, l’ISP a annulé 122 cours et cycles de formation prévus et confirmés pour le printemps 2020 et les a reportés à l’automne 2020 ainsi qu’en 2021. En dépit du coronavirus, tout a été mis en œuvre pour que les corps de police disposent de suffisamment de places de formation. C’est d’ailleurs dans cette optique que de nombreux cours sont doublés en 2021.
Réflexions sur la gestion de la crise sanitaire
Le premier objectif de la journée d’information des directions de cours ISP consistait à effectuer un examen critique de la gestion de la crise du coronavirus. À partir des résultats obtenus, des mesures prises et des expériences vécues, il s’agissait de tirer les premières leçons sur la manière dont les cours et cycles de formation de l’ISP peuvent être adaptés de manière optimale aux nouvelles circonstances et conditions cadres. Stefan Aegerter, chef du domaine « Formation et Perfectionnement » et directeur ad interim de l’ISP, s’est exprimé comme suit à ce sujet : « Les crises et autres situations extraordinaires débouchent sur du changement ; elles sont le catalyseur de l’innovation. » La rupture avec la routine dans pratiquement tous les domaines de la vie quotidienne a également contraint l’ISP à revoir les conditions cadres et les processus.
Il s’agissait notamment d’évaluer dans quelle mesure les cours de l’ISP pouvaient s’adapter à l’enseignement à distance et de définir les points à prendre en compte dans cette évaluation. En effet, si le travail de police est constamment guidé par le principe selon lequel « l’être humain est toujours au centre de l’activité policière », l’apprentissage numérique pose plusieurs défis, tant pour les directions de cours que pour les participantes et participants.
L’enseignement à distance comme suite logique ?
Anojen Kanagasingam, chef de domaine adjoint et responsable du sous-domaine « Examens et Certifications », a mené une discussion animée avec les directrices et directeurs de cours, durant laquelle plusieurs facteurs contribuant à la réussite d’un cours ou cycle de formation à distance ont été identifiés. L’offre de formation de l’ISP se base d’ailleurs sur une grande interactivité entre le personnel formateur et les personnes en formation. De nombreux cours reposent sur le travail en groupe, ce qui est difficile à réaliser virtuellement. Un autre inconvénient majeur de l’enseignement à distance est que les réactions immédiates des participantes et participants ne peuvent être observées que de manière très limitée. Il est donc difficile pour le corps enseignant d’adapter les cours de manière optimale aux besoins immédiats des participantes et participants.
Le distanciel nécessite donc au préalable des changements didactiques et méthodologiques minutieux du cours ou cycle de formation, qui prennent en compte les possibilités, défis et limites techniques. Afin de compenser l’écart entre distanciel et présentiel, il s’avère indispensable de faire preuve de créativité. Il est donc important que les directions de cours soient soutenues par des spécialistes expérimenté·e·s.
Des interactions humaines indispensables
Last but not least, une autre mission essentielle revient aux cours et cycles de formation : favoriser la création de réseaux entre les participantes et participants. Ce point a fait l’objet d’un large consensus. Il faut donc tout mettre en œuvre pour trouver des moyens de compenser au maximum l’absence d’échanges directs, formels comme informels, lors des cours et cycles de formation virtuels. Un enseignement hybride, qui se déroule en partie de manière virtuelle et en partie sur place de façon compacte, a été jugé le plus adapté. La combinaison distanciel – présentiel pourrait grandement favoriser l’apprentissage tout en permettant aux participantes et participants de nouer de précieux contacts.
Dans sa conclusion, Stefan Aegerter a fait la synthèse de la discussion sur la future organisation des cours et cycles de formation. Une tendance se dessine clairement : dans la mesure du possible, les échanges entre les personnes ne peuvent ni ne doivent se faire de manière virtuelle, mais doivent continuer à être garantis par un enseignement en présentiel. La priorité est donc de fournir un soutien et des optimisations grâce au numérique, et ce, également en ce qui concerne les supports de cours. En outre, il faut appuyer du mieux possible le système de milice qui a fait ses preuves et non le sacrifier sur l’autel de la numérisation en le surchargeant. La discussion a été lancée, mais est loin d’être terminée. Les questions d’avenir seront abordées dans une démarche commune.
Science-fiction ou réalité imminente ?
Au cours d’un exposé, Dilini Jeanneret, cheffe du domaine « Moyens d’enseignement » de l’ISP, a esquissé les tendances de l’évolution du rôle et de la mission du personnel enseignant et formateur. Pour ce faire, elle a étudié les données scientifiques relatives à la formation professionnelle en Suisse en s’appuyant sur la vision du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) dans le cadre du projet d’envergure intitulé « Formation professionnelle 2030 ». Dans un monde de plus en plus complexe où l’avenir semble incertain, l’agilité devient un atout essentiel. Cependant, agilité va de pair avec compétence. L’orientation vers les compétences dans la formation professionnelle en Suisse, introduite il y a plus de dix ans, vise à former les personnes de manière à ce qu’elles soient préparées aux nouvelles exigences du marché du travail et de son organisation. Ces personnes doivent apprendre à être agiles dans toutes les situations et à s’adapter rapidement aux nouvelles, notamment dans la vie professionnelle quotidienne (Seufert S. [2018], Flexibilisation de la formation professionnelle dans le contexte de la numérisation. Berne : SEFRI.).
Encourager l’apprentissage guidé et individuel sera essentiel à la réussite de cet apprentissage dans un avenir proche et témoigne des changements de paradigme actuels. Par conséquent, le personnel enseignant et le personnel formateur ne se « contentent » pas de transmettre leur savoir, mais accompagnent aussi les personnes en formation tout au long du processus d’acquisition des connaissances. Leur rôle se rapprochera donc de plus en plus de celui des mentor·e·s et des coaches. L’orientation vers les compétences est une autre tendance majeure qui devrait devenir la norme d’ici 2030.
Le modèle « humain » d’avenir
À l’avenir, une combinaison des formes d’apprentissage « analogique » et « numérique » permettra des échanges tant en face à face que virtuels entre l’ensemble des personnes concernées tout en faisant office de centre de connaissances et de compétences dans le domaine de la formation. Concrètement, cela nécessitera de nouveaux concepts pédagogiques et qu’un « leadership numérique », tout comme de nouvelles compétences, afin de pouvoir comprendre les opportunités et les risques d’une numérisation avancée et être en mesure de la structurer. De nouvelles conditions cadres sont requises pour soutenir le changement culturel nécessaire et un apprentissage autoguidé renforcé dans les institutions de formation.
« En résumé, la formation professionnelle ne se limite pas à transmettre des connaissances et des compétences, elle a aussi des effets sur le comportement tout en améliorant les qualités individuelles d’ouverture d’esprit, de flexibilité et d’efficacité dans la gestion créative des exigences inédites », explique Dilini Jeanneret. Outre le développement des compétences techniques, renforcer la personnalité des personnes en formation devient une priorité toujours plus claire. Les compétences complémentaires aux machines (intelligentes) et aux systèmes numériques, par exemple la créativité, l’esprit critique, l’ingéniosité ou l’empathie, revêtiront une importance croissante à l’avenir. (Seufert S. [2018], Flexibilisation de la formation professionnelle dans le contexte de la numérisation. Berne : SEFRI.).